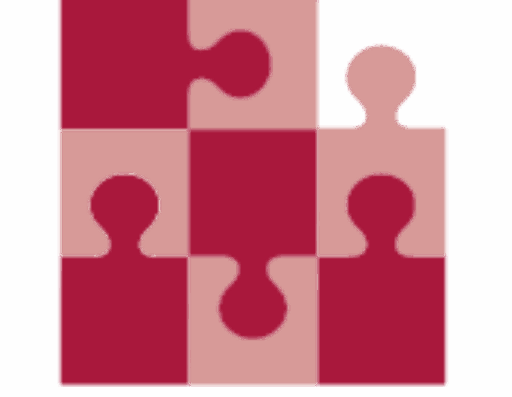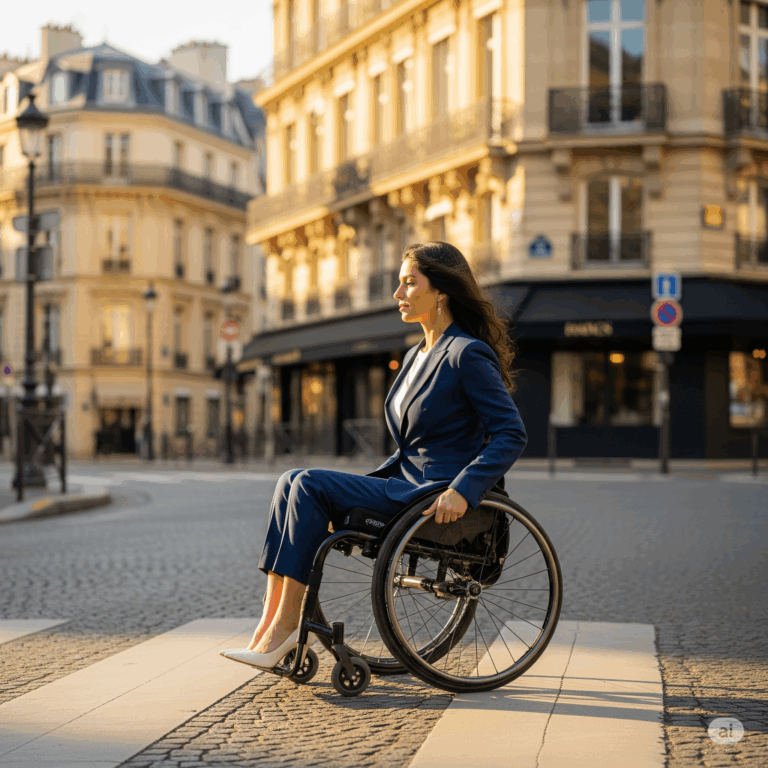Alors que des milliers d’enfants retournent sur le chemin de l’école chaque année au début du mois de septembre, la rentrée scolaire continue d’être un véritable parcours du combattant pour les élèves en situation de handicap.
Encadrement juridique
En effet, vingt ans après l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, l’école est devenue un milieu de plus en plus inclusif, investi par l’obligation de s’adapter aux difficultés de chacun. Le droit à l’éducation est ainsi érigé en droit fondamental pour les élèves en situation de handicap, consacrant l’inscription de chacun d’entre eux dans son école de quartier comme principe de base et incitant l’État à mieux répondre aux besoins particuliers. Ce dernier requiert, au-delà d’un besoin croissant en aide humaine, une accessibilité effective des établissements et des transports, et des réformes structurelles des ressources pédagogiques permettant un accès au savoir (supports de cours, méthodes n’excluant personne). L’article 19 de la loi du 11 février 2005 contribua ainsi à faire de l’éducation une priorité nationale et un droit pour chacun. De plus, le Code de l’éducation (art. L.112-1 et s.) affirme que chaque enfant a droit à une formation scolaire concourant à son éducation. Il prévoit également l’existence d’un projet personnalisé de scolarisation dans le cas où les besoins de l’enfant nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés. Ce dernier est élaboré par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) puis ensuite évalué par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Le rôle de la CDAPH est notamment de prendre les décisions concernant l’orientation scolaire, l’attribution du matériel pédagogique, les mesures d’accompagnement, l’aménagement de la scolarité.
Malgré l’existence d’un dispositif légal précis et cohérent, de nombreuses familles sont contraintes chaque année de se saisir de l’appareil médiatique pour y narrer les difficultés rencontrées dans le processus de scolarisation de leurs enfants atteints de handicaps. Le droit à l’éducation de beaucoup d’élèves présentant des handicaps lourds, est normalement rendu effectif, dans la majorité des cas, par la présence indispensable des AESH. Une fois encore, ce sujet est de nature à poser des difficultés, car de nombreux enfants n’ont pu être accompagnés lors de la rentrée, ou l’ont été pour un nombre d’heures insuffisant.
Chiffres
Selon les données révélées par la ministre chargée de l’Autonomie et du Handicap, 520 600 enfants handicapés attendaient cette année leur rentrée dans un établissement scolaire. Malgré l’existence de 134 000 Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap, généralement des femmes employées à temps partiel, l’offre demeure insuffisante.
Cette année encore, des milliers d’enfants demeurent sans solution éducative adaptée, entre scolarisation partielle, listes d’attente interminables et invisibilité administrative. A travers une enquête menée par l’Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) auprès de 38 associations représentant 3 603 enfants âgés de 3 à 16 ans, l’organisation dresse un constat édifiant: 13% des enfants n’auraient eu aucune heure de scolarisation par semaine, 38% entre 0 et 6 heures, et 30% entre 6 et 12 heures. Mais ce n’est pas tout, car les associations interrogées par l’Unapei disposaient de listes d’attente sur lesquelles ont été inscrits 4 410 enfants. Ces derniers n’auraient bénéficié d’aucun accompagnement de l’État à la rentrée. A défaut, ils furent scolarisés soit chez eux, soit en structure classique. L’organisation déplore ainsi le manque d’accompagnement adapté qui prive les enfants de leur droit d’accès à l’éducation et à l’égalité des chances.
Ces défaillances de prise en charge (scolarisation inadaptée, ruptures de parcours, manque de solutions et de professionnels…) ne sont pas sans conséquences sur le quotidien des familles d’enfants, qui voient bien souvent l’ensemble de leur organisation chamboulé. Certains parents déplorent en effet une absence totale de scolarisation, les contraignant à jongler entre intervenants à domicile et structures associatives.
Recours d’urgence
Au-delà des dispositifs existants, les familles sont souvent contraintes de saisir le juge administratif.
Le référé-liberté (art. L.521-2 CJA) peut être engagé en cas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’éducation. Le juge statue sous 48 h.
Le référé mesures utiles (art. L.521-3 CJA) permet de demander la mise en place rapide d’un accompagnement (AESH, matériel adapté) si la décision n’a pas encore été exécutée.
Indemnisation pour carence de l’État
De plus, les familles peuvent engager la responsabilité de l’État pour carence fautive. Dans un arrêt rendu le 19 juillet 2022, la Haute juridiction administrative a retenu que la carence de l’État à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants handicapés soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Le Conseil d’État reconnait tout d’abord l’existence d’un préjudice moral et de troubles aux conditions d’existence de l’enfant du fait de son absence de scolarisation. Les juges admettent par ailleurs les mêmes postes de préjudices pour les parents.
Cas pratiques
Par un jugement du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu la responsabilité de l’État pour défaut de prise en charge et l’a condamné à payer à la maman d’un jeune enfant atteint d’autisme la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et à l’enfant 20 000 €.
En 2015, la justice avait déjà sommé l’Éducation Nationale de leur fournir l’auxiliaire de vie (AVS) que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Essonne leur avait octroyé. Elle a aussi condamné l’État à rembourser les sommes que la famille a dû débourser pour pallier les carences de l’administration (Tribunal Administratif de Versailles, 21 janvier 2015 et 9 novembre 2017).
Conclusion
C’est ainsi que vingt ans après l’adoption de la loi Handicap, malgré des progrès notables, beaucoup d’élèves handicapés continuent de connaître des parcours scolaires jalonnés de ruptures. Le plus souvent, ces derniers se voient contraints d’achever leur scolarité avant le lycée, ce qui implique pour eux une sur-représentation dans les voies professionnelles. L’école inclusive reste ainsi un idéal encore inachevé en France. Les disparités persistent, les moyens demeurent insuffisants et de nombreuses familles continuent de se battre pour faire valoir les droits fondamentaux de leurs enfants. L’inclusion scolaire nécessite alors une allocation de ressources nettement élargie ainsi qu’une amélioration notable de la formation des enseignants. L’avenir de la scolarisation adaptée nécessitera une volonté politique forte et un engagement de l’ensemble de la communauté éducative pour que chaque enfant, quelle que soit sa différence, puisse bénéficier d’une éducation de qualité et adaptée à ses besoins.
Pour en savoir plus
Ines Chometon
Juriste
En savoir plus sur l’équipe du Cabinet Jehanne Collard et Associés
Photo : F.Chiche avec Gemini.